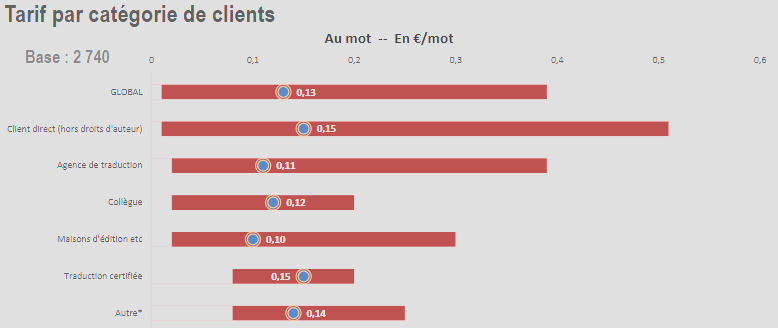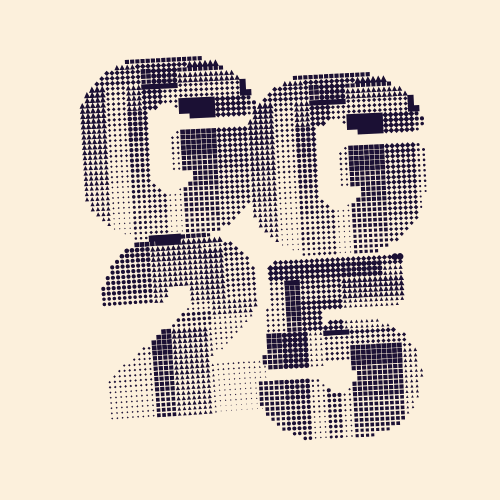Le mercredi 12 Mars dernier à l’Assemblée Nationale, la commission des affaires culturelles et de l’éducation, présidée par la députée Fatiha Keloua-Hachi, et la commission des affaires économiques, présidée par la députée Aurélie Trouvé, ont auditionné des représentant‧es du SNJV et du SELL, lobbies patronaux du secteur, et du CNC, organisme public en charge, entre autres, de l’attribution des subventions publiques du jeu vidéo. Cette audition avait pour but de comprendre la crise que le secteur ultra lucratif du jeu vidéo en France serait en train de subir, ses enjeux économiques et culturels. Cette audition peut être visionnée ici : Lien vers le site de l’Assemblée Nationale
L’industrie du jeu vidéo en France c’est un chiffre d’affaire de plus de 6,1 Milliards d’euros en 2023 (selon le SELL), une industrie en croissance constante depuis des décennies, et plus de 10 000 emplois menacés par l’inconséquence de nos dirigeant‧es. Le STJV et Solidaire Informatique ont été reçus par les présidentes de commission avant l’audition, ce qui nous a permis de discuter de ce que les travailleur‧ses du jeu vidéo vivent au quotidien, des causes structurelles et de gestion de la crise sociale en cours, de nos revendications et de la grève internationale du jeu vidéo qui a eu lieu le 13 février dernier et a mobilisé 1 travailleur‧se sur 5 dans l’industrie du jeu vidéo en France.
Les représentant‧es du patronat ont pu dérouler lors de l’audition leurs arguments mensongers, si éculés que nous avions pu les prédire presque au mot près aux député‧es. De la prétendue jeunesse de l’industrie à la concurrence qui serait « rude » (dans quel marché culturel ne l’est-elle pas ?), nous aurions pu faire un bingo des éléments de langages de ces robots VRP de l’industrie. Iels n’ont également pas manqué d’avouer leur incompétence en cherchant à se réfugier derrière une soi-disant « correction post-covid » que tout le monde était capable d’anticiper et en invoquant une « complexité » fantasmée de la production de jeux vidéos.
Conformément à leur rôle de lobbyiste, les représentant‧es patronaux ont cité le crédit d’impôts jeu vidéo (CIJV) au moins 10 fois pendant l’audition comme solution à quasiment tous les problèmes de l’industrie. Au lieu de régler les problèmes systémiques, dénoncés par les travailleur‧ses depuis des années, iels demandent toujours plus d’argent public pour arroser l’incompétence du patronat.
Malgré les importantes sommes versées, il n’existe pas de réel contrôle sur cette subvention, son utilisation et le respect de ses critères par les entreprises. Et le patronat ne veut pas qu’il y en ai : selon Anne Devouassoux, « il ne faut pas contraindre les entreprises ». On ne sait jamais, peut-être que cela améliorerait les conditions de travail, ce que les syndicats patronaux redoutent ? Il ne faudrait pas non plus, comme le CNC a pu le faire remarquer et qui est une revendication syndicale, que le jeu vidéo finance les subventions publiques du jeu vidéo… Les patron‧nes du jeu vidéo aiment prendre l’argent du cinéma, mais refusent de verser le moindre centime pour financer le CNC.
C’est bien beau de répéter en boucle devant les syndicats, les députés, les investisseurs, les juges… que les patron‧nes « ont conscience » des problèmes, de l’importance des travailleur‧ses, de l’insécurité de l’emploi et des problèmes de parité. Mais derrière tout ces discours, où sont les actions ?
Bien que ces sujets reviennent régulièrement sur le tapis en entreprise et malgré les questions, pourtant prévisibles, des député‧es, les représentant‧es du patronat :
- n’ont apporté aucune réponse aux problèmes des écoles et aux dérives des formations privées. Il n’ont font que brasser du vent sur une fantasmée « excellence française », bien loin de la réalité vécue par les étudiant‧es et sans un mot pour celleux-ci ;
- n’ont apporté aucune réponse concrète sur les problèmes omniprésents de sexisme et l’absence de parité dans les écoles et l’industrie ;
- n’ont apporté aucune réponse aux revendications sur les carrières et l’emploi, ou à la mobilisation des travailleur‧ses salariés et indépendant‧es.
Devant cette incapacité à répondre au moindre problème, que cela soit auprès des représentant‧es des salarié‧es ou des député‧es, il est logique de se demander si les patron‧nes servent à quelque chose. Tout travailleur‧se du jeu vidéo peut facilement constater dans son entreprise qu’iels ne servent effectivement qu’à empocher de grosses rémunérations et à gêner les productions.
Nous regrettons l’absence de représentant‧es des travailleur‧ses à cette audition. En effet, contrairement à leurs dirigeant‧es, les travailleur‧ses fabriquent les jeux et ont donc des réponses concrètes à apporter aux problèmes de notre industrie. Nous espérons pouvoir participer directement aux discussions dans le futur, pour ne pas laisser la parole aux patron‧nes du jeu vidéo.
Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo & Solidaires Informatique